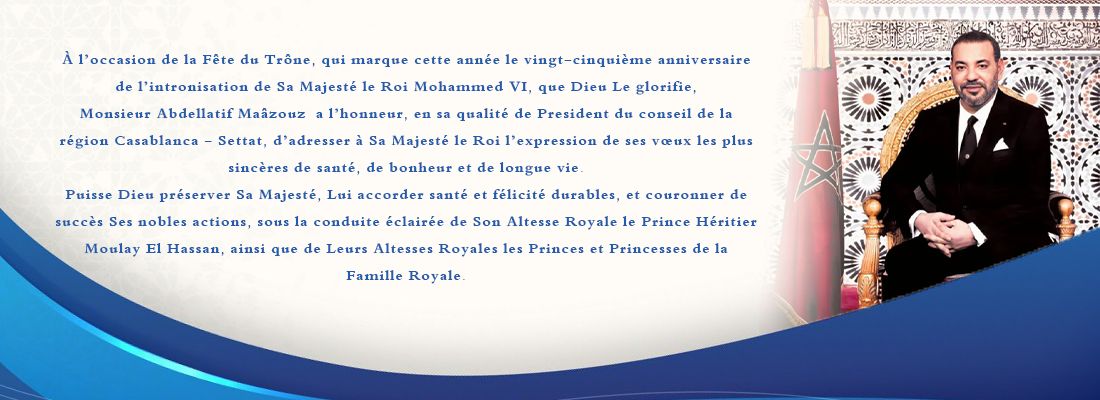Le Maroc traverse une crise inédite dans le secteur de la sardine, pilier de l’industrie nationale de la conserverie, en raison d’un enchevêtrement de facteurs humains, orchestrés par des lobbies puissants qui excellent dans l’art d’épuiser les ressources halieutiques et de contourner la loi, exploitant les failles du système de contrôle et leurs réseaux d’influence au sein des cercles décisionnels.
Selon des données obtenues par le journal, les volumes de sardines pêchées ont chuté de 30 % en 2023, puis de 22 % supplémentaires en 2024, avant de s’effondrer de 68 % au cours des quatre premiers mois de 2025 par rapport à la même période en 2022. Cette dégringolade a directement frappé les conserveries, qui ont réduit de moitié leur production, poussant certaines à fermer leurs portes, mettant en péril 35 000 emplois directs et 120 000 emplois indirects.
À Safi, l’un des principaux pôles de l’industrie, plus de la moitié des conserveries ont cessé leurs activités, ne laissant subsister qu’une vingtaine d’unités, selon le témoignage d’un industriel local. Officiellement, cette contraction est attribuée aux exigences strictes imposées par les marchés européens, notamment l’obligation d’utiliser des équipements modernes, ce qui a conduit les structures traditionnelles à se retirer. Mais, en réalité, la cause majeure réside dans la raréfaction des stocks, conséquence directe de la pêche intensive et incontrôlée.
Les côtes de Dakhla sont devenues un épicentre de la pêche illégale, menée par des navires importés d’Espagne après leur interdiction dans les eaux européennes. Ces bâtiments ciblent les stocks marocains de sardines et d’espèces protégées telles que le corbine et le pagre (bajo). Les informations recueillies indiquent que ces navires appartiennent à des personnalités politiques issues notamment du Parti de l’Istiqlal et du Rassemblement national des indépendants, ce qui expliquerait la faiblesse des interventions de contrôle. Les revenus générés par ces activités sont estimés à environ 400 millions de centimes par jour, acheminés clandestinement vers les marchés de Marrakech et Casablanca par le biais d’un réseau structuré aux ramifications nationales et internationales.
Des sources professionnelles révèlent que les lobbies de la pêche exercent une pression constante sur le ministère de la Pêche maritime pour bloquer ou atténuer les mesures de réforme, telles que l’instauration de quotas stricts ou le renforcement des sanctions contre la remise à la mer de poissons morts. Certaines revendications légitimes, comme l’augmentation des quotas de corbine, seraient instrumentalisées pour introduire davantage de souplesse législative, ouvrant la voie à une exploitation accrue.
Les experts en environnement avertissent que les pertes ne se limitent pas à l’épuisement des stocks, mais incluent aussi la destruction des écosystèmes marins, provoquée par le rejet anarchique de poissons morts, qui pollue les eaux et nuit à d’autres espèces.
Les associations écologistes et des professionnels réclament l’instauration d’un système de surveillance électronique obligatoire sur tous les navires de pêche, l’interdiction du rejet des poissons morts en mer, la limitation de l’usage de la sardine pour la fabrication de farine de poisson, ainsi que la publication des noms des propriétaires de navires contrevenants.
Selon plusieurs observateurs, le maintien de l’alliance entre les intérêts de la pêche illégale et la faiblesse des contrôles fait peser un risque majeur : voir le Maroc, aujourd’hui puissance maritime, se transformer en importateur de produits de la mer, dans un scénario catastrophique pour la sécurité alimentaire et l’économie nationale.